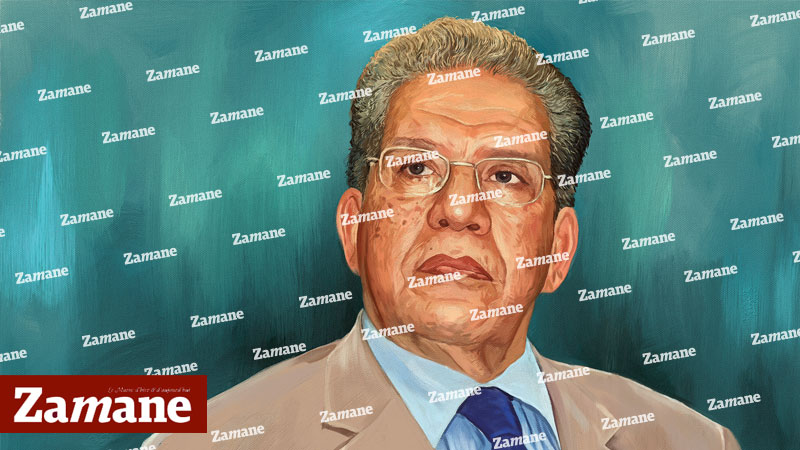La mini-révolution amenée par la culture et les arts, dans le Maroc des années 60 – 70, n’est pas tombée du ciel. Elle allait presque de soi. Il y avait un contexte et une combinaison d’éléments qui ont rendu cette «révolution» logique et naturelle. Et surtout très belle.
Le mot révolution peut paraitre exagéré. Ne surestimons donc pas cette hitoire. Mais ne le sous-estimons pas non plus. Surtout pas.
Au-delà de la portée d’un phénomène de société qui est resté essentiellement urbain, il faut examiner le moteur de cette mini-révolution. Nous parlons d’une jeunesse en perte de repères, d’espoir, de modèles. Une jeunesse en quête de pouvoir aussi. Qui avait soif, qui avait faim.
Et le pouvoir, dans le sens philosophique, c’est la liberté. Parler, chanter, danser, jouer, sauter, aimer, rire, respirer, être soi-même.
à défaut d’un récit national audible et surtout crédible, la jeunesse de la post-indépendance s’est tournée vers un récit transnational, celui de la Oumma arabe. Ce récit s’écrivait dans le Machreq, il irradiait jusqu’au Maghreb grâce à un phare qui s’appelait l’Egypte. Et puis Nasser s’est écroulé et le récit inachevé, et sans doute trop beau pour être vrai, s’est envolé.
Le réveil a été dur. Comme une violente gueule de bois. Alors la jeunesse est revenue aux basiques. Qui sommes-nous ?
Abdelkébir Khatib avait dit, un jour : « La littérature commence au moment où il y a une traduction exacte, assez rigoureuse, de ce que l’on est soi-même, là ou on est ». C’est juste. Et ça vaut pour la littérature comme pour le cinéma, la musique, le théâtre et toutes les formes d’expression artistique. L’art traduit ce que l’on est et ce que l’on a à dire. C’est un miroir des joies et des peines. Il dit tout et montre tout, surtout la colère. Il ne dit pas les choses mais les traduit.
C’est aussi un facilitateur. Il divertit et il instruit. Quand on a quelque chose à dire, il est plus agréable à l’oreille et à l’esprit de le chanter, de le jouer, de le dessiner. Dites ce que vous voulez, mais avec art. S’il vous plait !
Avant la démocratie, l’art était cet indispensable outil pour exercer ce qu’on appellerait aujourd’hui une forme d’opposition politique. C’est pour cela qu’il a toujours été populaire. Il servait à dire non.
La poésie berbère a exercé cette opposition quand le Maroc était sous protectorat. La ‘aïta s’est soulevé contre l’establishment politique qui contrôlait son environnement (caïds, gouverneurs, patriarches).
Et quand il ne contestait pas l’ordre politique, l’art transgressait les codes de la société. Repoussait les limites de la bienséance. Défiait la censure. Bravait les interdits. Il faut lire les vieux, très vieux textes de malhoun et de ‘aïta pour mesurer la liberté de ton de nos ancêtres.
La mini-révolution des années 60-70 était aussi héritière de cette liberté-là. Elle se nourrissait de la peur, de l’interdit, du sacré. Pour tout mettre à plat. Tout essayer. Tout goûter.
Bien entendu, le retour du bâton n’en fut que plus violent. Rafles, interdictions, emprisonnements, saisies des revues, fermeture des salles de théâtre, bannissement de la philosophie, de la sociologie, etc. Le réveil de la jeunesse marocaine, à l’orée des années 1980, fut terrible.
Cette mise sous scellé vaut pour l’art libre, la culture, mais elle vaut aussi pour la société. Et la classe politique.
C’est une histoire qui tourne mal à la fin. Mais qui ne finit jamais. Cette histoire, pour reprendre encore le grand Khatibi, c’est notre « mémoire tatouée ». Née dans la douleur, tuée dans l’œuf. Mais elle vit en nous, nous la portons à jamais.