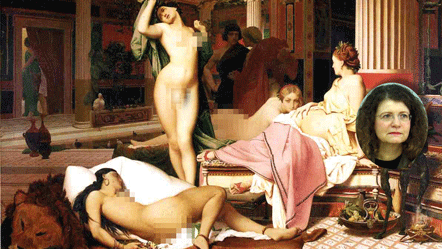Le harem, profondément au pouvoir, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, est encore enveloppé d’un voile de mystère (et de bon nombre de clichés). Jocelyne Dakhlia décrypte pour nous une institution à la réputation sulfureuse, mais en réalité hautement politique.
Quelles que soient les sources, le harem semble être protégé par une « règle du secret ». Pourquoi et d’où vient cette « règle » ? Est-ce dû à la peur du pouvoir sultanien, à un regard moraliste sur le harem ou à une culture délibérée du secret pour mythifier le harem ?
Le principe affiché du secret est consubstantiel à celui du harem, de « l’interdit ». Le harem est, dans un sens non spatial, la composante de la « Maison » interdite à d’autres hommes et protégée du monde extérieur. Mais il faut relativiser cette notion de secret. D’une part, cette protection concerne surtout les classes supérieures, elle a une dimension d’élitisme social et n’est pas générale. D’autre part, comme l’a souligné Leslie Pierce pour le cas du harem ottoman, cette exigence de se dérober aux regards du commun peut être le propre aussi des hommes des classes sociales supérieures et même du sultan. Un homme de haut statut social, dans la société ottomane, était aussi dissimulé aux regards, même dans la rue, entouré d’une cohorte de serviteurs, et il ne pouvait se mêler au commun en apparaissant dans la rue ou dans l’espace public. Enfin, il est important d’avoir à l’esprit que cette notion de secret est relative, car la porosité était grande avec le monde extérieur, par le biais d’une nuée d’intermédiaires : domestiques, esclaves, intendants, etc. Pour que la réclusion (plus ou moins poussée) de quelques femmes soit possible, il faut que d’autres soient au contraire au contact du monde extérieur et opèrent le relais avec lui. Le secret n’est donc jamais total. Mais le principe du secret va aussi de pair avec un principe de respect, de mystère et de puissance politique bien connu, sirr.
Le harem a-t-il un lien avec l’islam ou l’arabité?
N’a-t-il pas plutôt un lien avec le pouvoir, la royauté et le patriarcat ?
Ce que nous appelons communément le harem, le harem sultanien, est une expression parmi d’autres d’une très ancienne institution propre à quantité de sociétés : la polygynie sultanienne. Il y a des harems dans la Mésopotamie antique, mais aussi en Chine, au Japon, en Océanie… Dans bien des cas, nous pourrions aussi traduire harem par « gynécée », cette institution de la Grèce antique. Ce serait un terme plus neutre mais tout aussi juste. Nous devrions tout d’abord réapprendre à détacher la perspective de la polygynie (improprement appelée polygamie) de la seule histoire islamique car, sur un plan anthropologique, elle a été la règle dans une majorité des sociétés historiques. N’oublions pas que la polygamie mormone a longtemps été légale aux Etats-Unis et qu’elle connaît même aujourd’hui une forme de tolérance. Ce n’est pas une façon pour moi de la réhabiliter ou de la défendre, car il y a bien là une asymétrie patriarcale qui m’est insupportable en tant que femme, mais en tant qu’historien, on se doit d’effectuer une mise à plat des réalités factuelles. L’Europe elle-même a connu une polygamie de fait avec la réalité bien connue des favorites royales (et des favoris, etc.) ou des amours ancillaires. Le second plan de cette réalité est celui de la polygynie royale. Faut-il la lire comme un privilège du roi, ou du chef (car on voit bien, par exemple, comment, dans les phénomènes sectaires, s’opère ce type de privilège du chef, qui s’arroge un droit sur les femmes des fidèles)? Ou faut-il y voir une expression simplement plus importante d’une polygynie semblablement pratiquée dans l’ensemble de la société, sans rupture de sens ?
Propos recueillis par Nina Kozlowski
Lire la suite de l’article dans Zamane N° 69-70