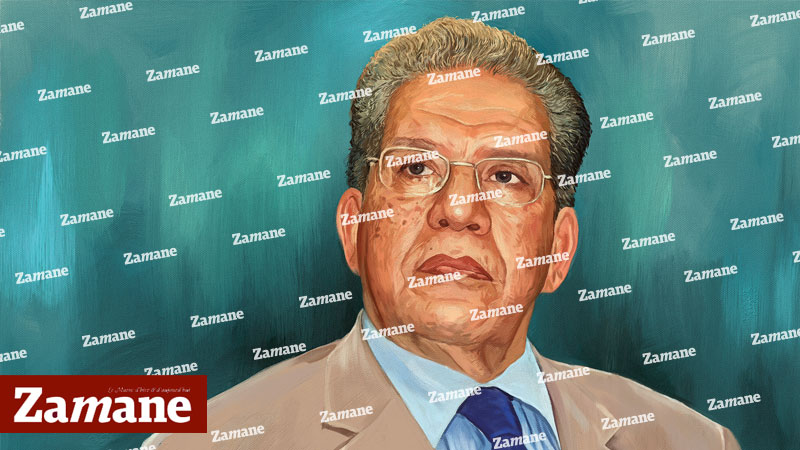Le Maroc est une monarchie séculaire. Voilà une lapalissade qui devient une tarte à la crème récurrente chaque fois que les politiciens sont à court d’arguments. Nous nous sommes, à la rédaction de Zamane, essayés à un exercice un peu moins linéaire, un peu plus regardant, en évitant et la facilité d’un préchauffé un peu défraîchi, et un révisionnisme historique à sens unique.
Nous sommes partis de deux idées directrices. Un, l’exercice du pouvoir monarchique à travers les âges et sous ses facettes les moins connues ; celles qui prêtent à l’étonnement et à la remise en question de quelques idées reçues et autres démarches préconçues. En somme, une mise sous observation, à la fois rétrospective et rapprochée d’une institution monarchique qui n’échappe pas à la griserie du pouvoir, mais qui, plutôt, l’amplifie à l’envie. Deux, la représentation populaire de ce pouvoir, à travers un imaginaire débridé où la frontière entre la réalité et le fantasme devient prodigieusement poreuse et difficilement saisissable.
Nous vous proposons, dans ce dossier, un recensement des aspects les plus insolites de ces deux approches que des historiens sérieux, acteurs, observateurs contemporains, visiteurs après coup et éplucheurs méthodiques d’archives ont relevé, transmis et validé ou invalidé. La longue procession monarchique, sur notre espace historique, en est truffée.
D’emblée, les différents témoignages nous confirment que la conquête du pouvoir —d’une dynastie à l’autre, ou au sein de la même filiation dynastique— n’a pas été une partie de plaisir. Les luttes de succession ont été féroces, y compris entre frères prétendants. Comme quoi, l’accession au trône du Maroc valait toutes les turpitudes, toutes les formes de violence et toutes les prises de risques. Et pour cause, le trône, objet de toutes les convoitises et de toutes les projections instinctives, était synonyme de pouvoir absolu, parfois de vie dissolue. Sur ces deux faces d’une même monnaie, les récits sont d’une véracité narrative épouvantable.
Certains sultans du Maroc étaient capables d’actes de barbarie sans égal et de cruauté terrible. On mutile et on jette aux oubliettes dans des conditions horribles, sur une saute d’humeur ou un vague ouï-dire. Lorsqu’on tombe en disgrâce sous un nouvel avènement sultanien ou que l’on est en délicatesse avec les proches du sultan, on est exposé aux pires sentences vengeresses, sans autre forme de procès et sans états d’âmes. A l’épreuve de certaines narrations, l’imagerie, obligeamment véhiculée, de quelques figures sultaniennes est littéralement démontée.
Au fil de notre dossier de couverture, un facteur transparaît en filigrane ou carrément sur les lignes, la position spatiale du palais royal. A Marrakech, à Fès, à Rabat ou à Meknès, le palais n’est pas vraiment situé en dehors de son environnement social. Il n’est pas non plus immergé dans cet espace de vie. Il paraît plutôt lointain, presque en rupture avec son voisinage immédiat. Lorsqu’on passe à côté de ces monuments chargés d’histoire et de génie architectural, la vision se heurte d’abord à la haute muraille qui les ceinture comme pour les isoler, en tout cas les mettre à l’écart dans un espace clos où toute curiosité est interdite et tout regard indiscret est une transgression. Résultat, il n’y avait de communication avec le palais ou sur le palais qu’à l’occasion d’un cérémonial religieux ou d’actes officiels à caractère politique.
Cette rareté extrême d’information que l’on traduit par l’absence de communication, renforçant le sentiment de mystère qui entourait cet endroit unique où « la vie de palais » n’était certainement pas la même pour tous. Circonstances spécifiquement aggravantes, le palais royal était le point nodal du pouvoir central et de la gouvernance nationale. Il en était l’unique dépositaire. Une divine unicité inexpugnable.
La question à deux étages qui vient à l’esprit, au terme de notre dossier de ce mois de juillet, est la suivante :
Ce dispositif monarchique, multiséculaire, a-t-il réellement vécu, au regard de faits et de périodes beaucoup plus récents ?
A-t-il été suffisamment esseulé pour ne plus avoir d’usage que pour l’entretien de notre mémoire historique ; et pour les besoins pressants d’une modernité incontournable ? Questions ouvertes.
Youssef Chmirou, directeur de la publication